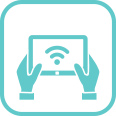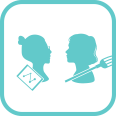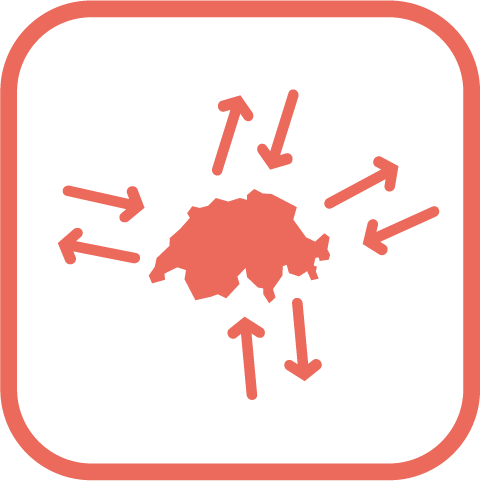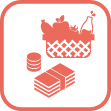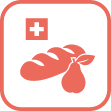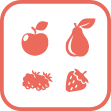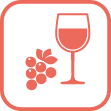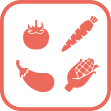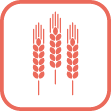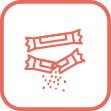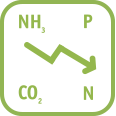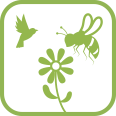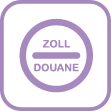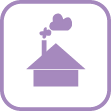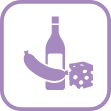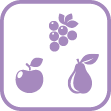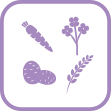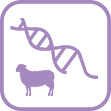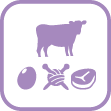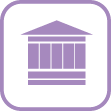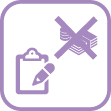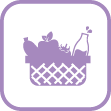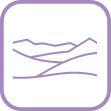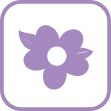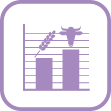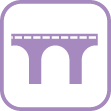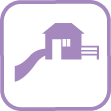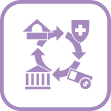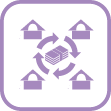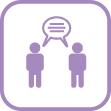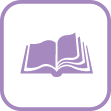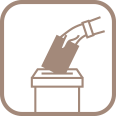Intensification écologique de l’agriculture
L’agriculture suisse a beaucoup évolué au cours des 35 dernières années. La surface agricole utile a reculé, tandis que la part des surfaces gérées de manière particulièrement écologique a progressé, sans que la production en pâtisse. En dépit des améliorations, l’impact sur l’environnementale reste trop fort.

Source : Fotalia, Adobe Stock et OFAG
L’agriculture adaptée aux conditions locales se définit comme l’exploitation optimale du potentiel de production d’un site dans la limite de résilience des écosystèmes. C’est pour la Suisse autant un objectif à atteindre qu’un défi à relever. Le présent article illustre l’évolution de la production et, par conséquent, de son impact sur l’environnement au cours des 35 dernières années.
On connaît d’un côté la production agricole normale-intensive, assurée selon les bonnes pratiques agricoles, qui fournit les prestations écologiques requises et produit une grande partie de nos denrées alimentaires. De l’autre, il y a les surfaces de promotion de la biodiversité et d’autres surfaces exploitées de manière particulièrement écologique, où les ressources naturelles vitales sont préservées ou favorisées de manière ciblée. Ces surfaces contribuent aussi significativement à la production, en assurant les bases de la production à long terme.
Légère baisse de la surface agricole utile
Alors que la surface agricole utile a légèrement reculé en Suisse depuis l’an 2000, principalement en raison de l’urbanisation croissante, la part des surfaces exploitées de manière extensive a augmenté de manière constante durant cette période. Le graphique ci-dessous montre pour quelle part de la surface agricole utile des paiements directs ont été versés dans le cadre de la promotion de la biodiversité ou de la protection des végétaux respectueuse de l’environnement.
Évolution de la surface agricole utile en hectares
Baisse du nombre d’animaux dans les années 90
Le nombre d’animaux de rente gardés en Suisse a également reculé au cours des 35 dernières années, la baisse ayant eu lieu surtout dans les années 1990 et les chiffres étant depuis restés relativement stables.
Évolution des effectifs d’animaux de rente en unités de gros bétail
L’évolution des effectifs d’animaux de rente est représentée à l’aide d’unités de gros bétail (UGB), qui permettent de regrouper sous le même critère différentes espèces animales. Une UGB équivaut à une vache laitière. Cette définition de l’ordonnance sur la terminologie agricole est restée inchangée en dépit du fait que la productivité des animaux de rente ait considérablement évolué au cours des dernières décennies. À titre d’exemple, la production laitière moyenne d’une vache laitière, et donc ses rejets d’éléments fertilisants, a fortement augmenté pendant la même période.
Évolution du nombre de vaches laitières, de leur productivité et de leur production laitière
La hausse de la productivité des vaches laitières explique le fait que la production de lait, bien que fluctuante, ait tendance à se maintenir malgré la baisse du nombre de vaches laitières depuis 1990 (Agristat [2024], Statistique laitière de la Suisse 2023).
Production agricole stable
Ainsi que le montre le graphique ci-dessous, le niveau de rendement de l’ensemble de l’agriculture suisse, exprimé en gigajoules d’énergie alimentaire, fluctue d’année en année entre 1994 et 2022, sans qu’il soit possible d’en dégager une tendance claire. La production agricole se situe donc aujourd’hui à un niveau comparable à celui de 1990, en dépit d’une nette diminution de la surface agricole utile comme du nombre d’UGB.
Évolution de la production agricole
Amélioration des prestations écologiques, mais objectifs pas encore totalement atteints
Les prestations écologiques de l’agriculture suisse se sont nettement améliorées, notamment grâce à un soutien ciblé. Les objectifs environnementaux de l’agriculture ne sont malgré tout pas atteints dans tous les domaines, comme le montrent le monitoring agro-environnemental et les données, indicateurs et cartes sur l’évolution de l’état de l’environnement de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Des améliorations demeurent nécessaires.
Hausse de la production et réduction de l’impact environnemental
Au cours des 35 dernières années, une partie des terres agricoles a fait l’objet d’une intensification de la production, tandis que l’autre partie a vu son exploitation devenir plus écologique et donc plus extensive. Cette évolution s’est accompagnée d’un renforcement des prestations écologiques et signifie que l’efficacité de la production agricole en Suisse a pu être globalement améliorée.
Cette intensification écologique doit se poursuivre. La production agricole doit augmenter, afin d’améliorer le degré d’autosuffisance face à la croissance démographique. Pour ce faire, il faudra encore améliorer l’efficacité de l’agriculture, dans la limite de résilience des écosystèmes et en préservant les ressources naturelles vitales. Ces mesures devraient assurer le potentiel de production à long terme.
Le potentiel de la production adaptée aux conditions locales
Les bonnes pratiques au bon endroit : c’est là que tout se joue. Il s’agit d’exploiter de manière optimale le potentiel de production d’un site pour produire des denrées alimentaires, tout en tenant compte des sensibilités de l’emplacement, en particulier le choix des cultures et les mesures d’exploitation. Lorsqu’il y a un risque accru d’introduction de substances dans la nappe phréatique à un endroit où l’on capte de l’eau potable, les mesures indiquées diffèrent de celles appliquées dans des écosystèmes particulièrement sensibles et en présence d’émissions d’ammoniac trop élevées.
En résumé, une agriculture adaptée au site signifie ne pas faire partout la même chose. Les interactions étant complexes, de bonnes bases techniques sont nécessaires pour évoluer dans la bonne direction. L’OFAG et Agroscope travaillent en ce sens.
Sources
Agristat (2024), Statistique laitière de la Suisse 2023, page 32
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».